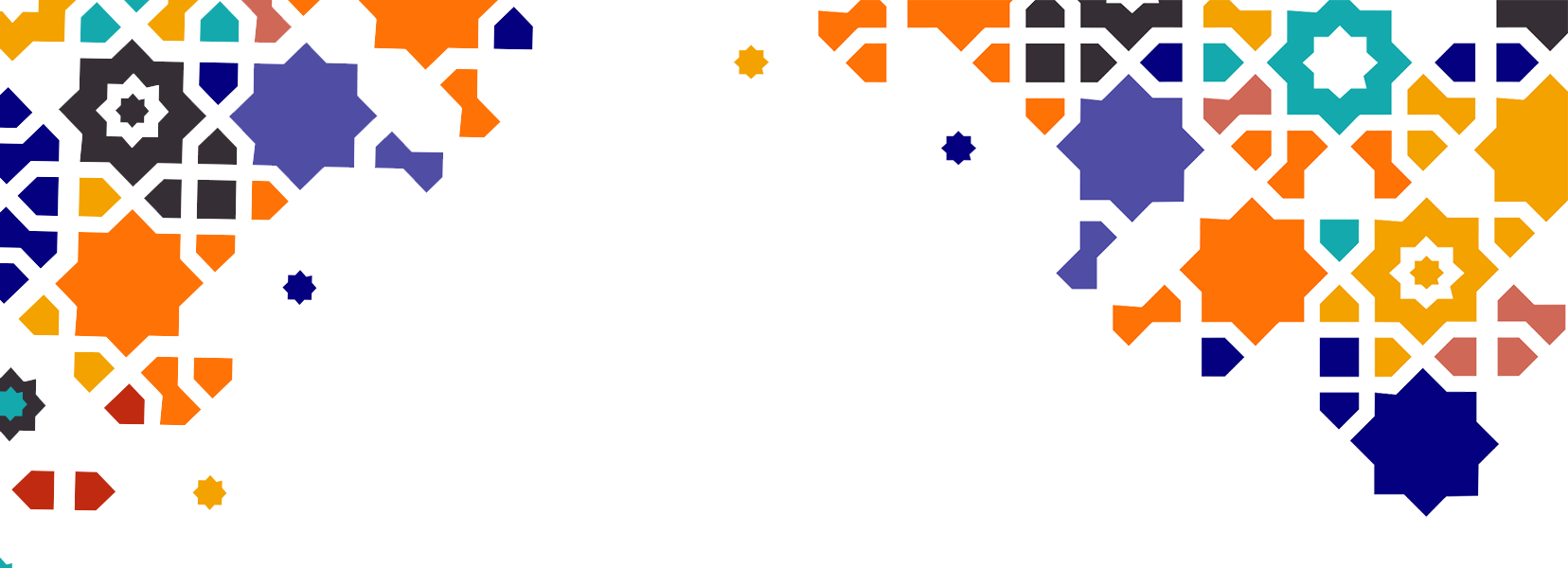
La Poésie comme Chronique : Le cas d’Iyani Shirazi

La persistance du poème de Tennyson comme chronique durable d’une guerre révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine. L’Histoire, en général, se présente vêtue d’armure : chronique, décret, registre fiscal — autant d’archives soigneusement ordonnées du pouvoir et de l’ordre. Mais c’est la poésie qui conserve ce que les registres oublient : les traces complexes d’allégeance, les tremblements inévitables de la peur, et les fragiles élans d’espérance. Un poème est parmi les expressions les plus humaines : une manière de dire « J’étais là, et j’y suis resté assez longtemps pour créer. »
Le Deccan des Bahmanides
Pour saisir cette vérité au-delà du canon anglo-saxon, il faut se tourner vers un autre lieu, une autre époque : le Deccan bahmanide.Ce sultanat, fondé en 1347, s’étendait sur les hauts plateaux du centre-sud de l’Inde, gouvernant d’abord depuis Gulbarga puis Bidar jusqu’à sa dissolution en 1528. Ce fut le premier royaume musulman souverain établi en Inde. Bien que géographiquement indien, la cour bahmanide baignait dans une culture profondément persane. Le persan y était la langue du pouvoir et du prestige. Savants, soldats et poètes affluaient d’Iran et d’Asie centrale, se mêlant aux élites locales du Deccan et aux puissants commandants abyssins (d’Afrique de l’Est). Des figures comme Mahmud Gawan, marchand originaire du nord de l’Iran devenu vizir et mécène, transformèrent Bidar en l’un des centres les plus brillants de la littérature persane en Inde.2
À son apogée, le royaume bahmanide n’était pas seulement une puissance politique, mais aussi un haut lieu de littérature, de philosophie et de dévotion soufie. Mais la cour ne fut jamais stable. Ses luttes internes se cristallisèrent en factions rivales : d’un côté, les Ghariban (« étrangers »), aristocrates turco-persans ; de l’autre, les Dakanis, élites indigènes issues de lignées établies depuis plusieurs générations. La division fut institutionnalisée, chaque camp siégeant de part et d’autre de la salle du trône. Les affrontements éclataient régulièrement. Les tentatives de compromis — la plus célèbre étant celle de Gawan — se soldèrent par des bains de sang. Peu à peu, l’équilibre fragile de ce royaume persanisé s’effondra, donnant naissance à des États successeurs.3
C’est dans ce paysage fracturé qu’apparut Iyani, poète obscur originaire de Chiraz, qui fit carrière à Bidar à la fin du XVe siècle. Son principal mécène était Habib al-Din Muhibballah, descendant du saint soufi Shah Ni‘matallah Wali de Kerman. Son œuvre, tout ce qu’il en reste, ne subsiste que dans un unique manuscrit conservé aujourd’hui à Chennai. Ce recueil contient ses odes de louange, ses quatrains méditatifs, ses ghazals d’amour persans et deux longs poèmes narratifs. Le manuscrit, d’une exécution raffinée, présente des marges dorées et une écriture soignée, mais porte aussi les traces de lecteurs ultérieurs qui ont effacé certains vers à la peinture bleue, gênés par la portée politique de ses louanges. Les cicatrices du manuscrit en disent autant sur la destinée posthume des mots d’Iyani que sur leur composition d’origine.4
Iyani, de son vrai nom Saad, se désignait fièrement comme un gharib dans toute sa poésie. Le mot était biographique : ses vers révèlent qu’il quitta l’Iran à la fin des années 1430, et, même après des décennies passées en Inde, il confessait encore « la brûlure de mon âme pour ma patrie ». Mais le mot était aussi politique : se dire gharib à la cour bahmanide revenait à se ranger du côté de l’élite migrante dans sa rivalité avec les Dakanis. En un seul mot, Iyani s’inscrivait à la fois comme victime de l’exil et comme rouage indispensable d’un appareil politique. Bien qu’oubliée aujourd’hui, sa poésie fut un témoignage vivant de l’effondrement d’un empire.
Dans un poème, Iyani pleure les violences de faction à Bidar, où une grande partie de son œuvre fut perdue dans les pillages :
« Mon cœur brûle de chagrin pour mes livres et mes écrits. »
Tout créateur ayant vu son travail détruit peut encore compatir à cette douleur.
Dans un autre poème, Iyani comparait ses compositions au Shahnameh, l’épopée nationale de l’Iran, écrite quatre siècles plus tôt par Ferdowsi.
Illusions de grandeur réduites en rêves brisés un refrain familier à bien des artistes et écrivains.
Le Fath-nama
Son œuvre majeure, le Fath-nama-yi Mahmud Shahi, relate la répression d’une rébellion au début des années 1490. Le poème raconte la victoire bahmanide sur Malik Dastur Dinar, esclave abyssin qui tenta d’établir son propre pouvoir à Gulbarga. Sous le règne de Mahmud Shah, les luttes de factions devinrent endémiques et finirent par fracturer la dynastie. De ces divisions naquirent de nouveaux États, fondés pour la plupart par d’anciens esclaves-soldats. Le Fath-nama d’Iyani est un témoignage rare et de première main sur la révolte de Dastur Dinar, l’un des deux seuls récits historiques du sultanat bahmanide à avoir survécu à sa désintégration.
En surface, le poème n’est que éloge : le sultan y est comparé au roi Salomon et aux grands souverains de l’Iran ; Muhibballah y apparaît comme le sauveur du royaume ; Dastur Dinar est défait et capturé, mais gracié par un monarque miséricordieux. Avec la rébellion écrasée, Bidar est décrite comme un fragment du Paradis. Tout cela, bien sûr, est savamment enjolivé. Mais cette emphase même est une forme de témoignage. Lorsque les institutions chancellent, la légitimité se répare à coups de miracles et de généalogies. Les historiens ultérieurs, écrivant à distance, adoucirent le récit, attribuant le pardon du rebelle à d’autres figures, ou détournant la faute du trône. C’est dans ces divergences que la réalité affleure : un État si fragile qu’il devait s’abriter derrière les poètes et les conteurs pour se protéger du regard trop sévère des chroniqueurs.
La Cadence humaine
Albert Memmi, réfléchissant sur la condition des Juifs dans les pays arabophones au XXe siècle, écrivait :
« Dans nos souvenirs et notre imagination, c’était une vie merveilleuse, alors que nos journaux d’alors témoignent du contraire. »
Une observation puissante et intemporelle sur la nature humaine : la mémoire perdure non pas malgré ses déformations, mais à cause d’elles.
Elle se nourrit de nostalgie, se colore d’embellissements, se sucre de désirs. Souvent, le poème et la chanson survivent à la réalité, précisément parce qu’ils sont plus doux que la vérité.
Quoi qu’on puisse dire d’Iyani de Chiraz, il fut un homme marqué par la douleur et habité par le désir de son pays natal. Un homme d’exil et de déplacement, de dévotion et d’admiration envers la grandeur de ses mécènes mais aussi d’ambition, espérant un jour se hisser à leur hauteur. L’histoire nous assure qu’Iyani a bel et bien vécu ; ses poèmes, eux, nous rappellent qu’au milieu du chaos et de la ruine, il était une âme humaine, cherchant, comme nous, à arracher un sens aux décombres.
Références
[1] https://www.poetryfoundation.org/poems/45319/the-charge-of-the-light-brigade, accessed 10 September 2025.
[2] https://www.iranicaonline.org/articles/bahmanid-dynasty-a-dynasty-founded-in-748-1347-in-the-deccan-sanskrit-daksia-lit/, accessed 10 September 2025.
[3] A.C.S. Peacock, “‘ʿIyānī, A Shirazi Poet and Historian in the Bahmani Deccan”, Journal of the British Institute of Persian Studies, 59:2 (2021), p.173.
[4] Ibid., pp.170-71.
[5] Ibid., pp.172-73.
[6] Ibid., p.174.
[7] Ibid., p.176.
[8] Ibid., p.178.
[9] Ibid., pp.180-81.
[10] Albert Memmi (trans. Eleanor Levieux), Jews and Arabs (Chicago: J. Philip O’Hara Inc., 1975), p.28.

